 « Nous ne sommes pas spontanément présents à notre temps. Nous tendons à vivre ailleurs, en arrière, à côté, nous le traversons en somnambules. L’entreprise difficile est de devenir son propre contemporain », Marcel Gauchet, La condition historique.
« Nous ne sommes pas spontanément présents à notre temps. Nous tendons à vivre ailleurs, en arrière, à côté, nous le traversons en somnambules. L’entreprise difficile est de devenir son propre contemporain », Marcel Gauchet, La condition historique.
S’il était devenu indifférent d’être moderne, comme le disait Roland Barthes à son propos, il reste toujours difficile d’être de son temps – surtout aujourd’hui où le seul mode d’être permis est celui de l’excès critique ou laudatif. Que nous approuvions ou que nous désapprouvions notre monde, il faut toujours que cela le soit jusqu’à la nausée. Ainsi les uns se féliciteront à outrance des progrès de nos mœurs, les autres tireront à boulet rouge sur ceux-ci. L’on dira de la démocratie qu’elle est formidable car elle permet le triomphe de la culture pour tous (mentalité Steevy), en même temps qu’on l’accusera d’être le lieu de la déculturation générale (mentalité Renaud Camus). L’approbation hystérique à tout ce qui est moderne ira de pair avec la radicalité critique de cette même modernité. Contre un « réac », cent « bobos » : voyez saint Germain des Prés, mais contre un « bobo », mille « réacs » : voyez la blogosphère. Mille "réacs" qui ne sont pourtant pas grand-chose face au Cran, au Mrap, à la Licra, à la Halde, ces ligues de vertu et de répression toutes puissantes les unes que les autres et qui constituent l'empire du bien qui est désormais notre (im)monde. Parallèlement, jamais il n’y eut autant de ponts incongrus entre certains partis ou de mariage contre nature entre certaines obédiences. Bruns et rouges se combattent puis s’associent (Alain Soral chez Le Pen), noirs pro-noirs et blancs pro-blancs se retrouvent dans leur même haine du métissage (Dieudonné chez Le Pen), catholiques intégristes et islamistes se découvrent mille points communs antisémites (Le Pen soutenant Ahmadinejad), fils (et filles !) d’Allah comme bâtards de Marx rêvant de bombarder Israël et les Etats-Unis (là, impossible de mettre des noms sans danger) [on pense évidemment à Tarik Ramadan, Olivier Besancenot, Kémi Séba, Houria Bouteldja, et autres putes et soumis aux idéologies sanglantes tendance Lénine-Khomeiny]. Certes, la minorité majoritaire préfère adopter des postures plus futiles, qu’elles soient cléricalement anticléricales à la Michel Onfray, normativement libertines à la Catherine Millet (quoique la dame aux dix mille touzes soit très sensible à l’adultère, peuchère ?) ou agressivement neuneu à la Christine Angot. La tendance générale reste à la critique systématique. Dans la France de ce début de vingt et unième siècle, tout le monde ressemble à Voltaire et à Léon Bloy.
En philosophie, la situation est pire – la radicalité dogmatique ou critique l’ayant emporté dans presque tous les camps. A l’essentialisme de la droite répond le réductionnisme de la gauche. A la métaphysique tout azimut des traditionnalistes, s'oppose la sociologie débordante et décourageante des positivistes. Nous qui refusons de choisir entre les sbires de Joseph de Maistre et ceux de Karl Marx, nous que Pierre Bourdieu et Alain de Benoit ennuient mêmement, nous qui en avons un peu marre d'Alain Finkielkraut mais qui ne pouvons suivre Emmanuel Todd dans son antisarkozysme pathétique, nous qui en avons assez de cette France qui ne s’aime pas ou qui s’aime trop, nous sommes à la recherche désespérée d’un penseur qui pourrait transcender les idéologies, outrepasser les conflits, et surtout penser le monde hors de tout idéalisme et de tout réductionnisme. Marcel Gauchet serait-il celui-là ?
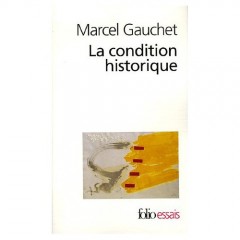 1 – Qu’est-ce que la condition historique ?
1 – Qu’est-ce que la condition historique ?
Dans La condition historique, passionnant recueil d’entretiens avec François Azouvi et Sylvain Piron, l’auteur capital du Désenchantement du monde définit son projet comme « une anthropologie transcendantale », c’est-à-dire comme une méthode historique et philosophique permettant la prise en compte de la condition de l’homme contemporain dans ce qu’elle a de nouveau. Qu’est-ce qui fait qu’il y ait humanité, qu'est-ce qui fait qu'il y ait possibilité d'une société, qu'est-ce qui fait qu'il y ait histoire - telles sont les questions.
La société, comme la possibilité de son émancipation, est une invention du XIX ème siècle. Contre Nietzsche et toute la philosophie classique qui pensaient que la liberté ne pouvait convenir qu’à quelques hommes supérieurs, Marx et les modernes ont cru qu’il suffirait que la société soit pleinement elle-même pour que nous devenions « tous » libres. Le processus révolutionnaire, croyait-on sans rougir, nous débarrasserait de toutes les aliénations socio-culturelles et l’homme serait rendu à lui-même, c’est-à-dire non plus à sa dimension individuelle (fantasmagorie bourgeoise et capitaliste) mais à sa dimension transindividuelle et collective (fantasmagorie communiste et exterminatrice). Quelque soixante dix ans de goulag et de laogaï n’altérèrent pas ce qui est encore considéré aujourd’hui par beaucoup comme un idéal indépassable de la condition humaine. Combien d’intellectuels et de simples quidam qui, cent millions de morts ou pas, refusent toujours d’admettre que l’ontologie marxiste fut la plus grande erreur fondatrice de tous les temps ?
La force de cette erreur provient d'une confusion anthropologique... forcenée. Alors que la pensée orthodoxe classique considère l'homme avant tout comme un être qui se définit selon ses désirs (lieu de nos inégalités), la pensée marxiste estime, elle, que l'homme est un être qui se définit en premier et en dernier lieu selon ses besoins (lieu de notre égalité.) Le marxiste fait fi des véritables désirs humains que sont la religion, l'art, le goût du luxe et de l'alcool, et considère avec une certaine férocité que ces derniers ne sont que des illusions sociales - alors qu'ils ne sont que des illusions vitales. Le marxiste, et d'une manière général l'athée, est celui qui veut penser la vie sans illusion, sans se rendre compte que la vie sans illusion, c'est-à-dire sans amour, sans luxe, sans dieux, sans caviar, sans rituel, c'est la mort. Et de fait, le communisme, dans son idéal et dans son application, ce fut cent millions de de morts - et sans doute autant en esprits ravagés, "séduits".
 Le vice fondateur de la pensée marxiste est qu'elle ne pense la vie qu'en fonction de la survie. Le dialecticien matérialiste refuse de toutes ses forces le fait réel, c'est-à-dire métaphysique, que l’homme se pense non selon sa survie mais selon sa vie - et peut-être encore plus selon sa mort. Comme le dit Pascal, être humain, ce n'est pas craindre la mort simplement dans le péril, c'est la craindre hors du péril. Or, le marxiste se fout du silence éternel des espaces infinis comme d'une guigne. Lui ne croit qu’au « concret » sans se rendre compte que le « concret » ne fut toujours que le degré zéro de la réalité. Toute l’histoire du monde montre que l’humanité a toujours été plus sensible au symbolique, au moral et au métaphysique qu’au matérialisme dialectique. Toute l’histoire du monde montre que c’est la condition historique qui définit l’homme et non pas sa condition «naturellle». Le marxiste croit que l’homme veut avant tout contenter ses besoins primitifs avant de contenter ses besoins spirituels. « La bouffe d’abord, la morale après ! », hurlait un personnage de Bertold Brecht. Mais en Inde, on est prêt à mourir de faim plutôt que de tuer une vache. Et en Afrique, on laisse de côté tous les sacs de « bouffe » occidentale que on ne sait pas cuisiner. C’est que l’homme se définit moins selon son estomac que selon ses papilles. Ce qui l’intéresse, même en état de famine, ce n’est pas la bouffe, c’est la cuisine. Sa cuisine. Ses rituels. Sa façon de saler et de poivrer. L’homme, c’est là sa grandeur et sa spécificité, est prêt à mourir si on le réduit simplement à sa survie – ce que fait le marxiste. Le marxiste voit en l’homme un tube digestif. Or, l’homme est d’abord un tube métaphysique et qui se définit comme tel. C’est pourquoi « l’idéal communiste », qui ne croit ni à la métaphysique ni à la transcendance ni à l’individualité ni à l’intériorité, reste réellement la plus grande négation de l’humanité.
Le vice fondateur de la pensée marxiste est qu'elle ne pense la vie qu'en fonction de la survie. Le dialecticien matérialiste refuse de toutes ses forces le fait réel, c'est-à-dire métaphysique, que l’homme se pense non selon sa survie mais selon sa vie - et peut-être encore plus selon sa mort. Comme le dit Pascal, être humain, ce n'est pas craindre la mort simplement dans le péril, c'est la craindre hors du péril. Or, le marxiste se fout du silence éternel des espaces infinis comme d'une guigne. Lui ne croit qu’au « concret » sans se rendre compte que le « concret » ne fut toujours que le degré zéro de la réalité. Toute l’histoire du monde montre que l’humanité a toujours été plus sensible au symbolique, au moral et au métaphysique qu’au matérialisme dialectique. Toute l’histoire du monde montre que c’est la condition historique qui définit l’homme et non pas sa condition «naturellle». Le marxiste croit que l’homme veut avant tout contenter ses besoins primitifs avant de contenter ses besoins spirituels. « La bouffe d’abord, la morale après ! », hurlait un personnage de Bertold Brecht. Mais en Inde, on est prêt à mourir de faim plutôt que de tuer une vache. Et en Afrique, on laisse de côté tous les sacs de « bouffe » occidentale que on ne sait pas cuisiner. C’est que l’homme se définit moins selon son estomac que selon ses papilles. Ce qui l’intéresse, même en état de famine, ce n’est pas la bouffe, c’est la cuisine. Sa cuisine. Ses rituels. Sa façon de saler et de poivrer. L’homme, c’est là sa grandeur et sa spécificité, est prêt à mourir si on le réduit simplement à sa survie – ce que fait le marxiste. Le marxiste voit en l’homme un tube digestif. Or, l’homme est d’abord un tube métaphysique et qui se définit comme tel. C’est pourquoi « l’idéal communiste », qui ne croit ni à la métaphysique ni à la transcendance ni à l’individualité ni à l’intériorité, reste réellement la plus grande négation de l’humanité.
Hélas ! Nous avons beau nous en défendre, nous-mêmes, nous tous sommes peu ou prou marxistes. Combien d’entre nous, par exemple, perdurent dans cette mauvaise croyance sociologique qui prétend que l’économique est la clef du politique ? Pour Marcel Gauchet, c’est bien évidemment le politique qui explique l’économique. Qu'on soit libéral ou socialiste, force est de constater que la loi du marché ou l’emprise de l’état ne sont jamais que la résultante de choix politiques, idéologiques, et nous allions dire : anthropologiques. Croire que tout est économique, c’est comme croire que tout est fécal. Cela dit, nos sociétés athées qui ne croient qu’à l’économie, c’est-à-dire qu’à leur merde, se rendent après tout justice à elles-mêmes.
La vérité est que l’homme résulte non pas tant de la lutte des classes que de la luttes des idées, sinon de la lutte des désirs. L’homme, disait Nietzsche, est la configuration de ses dominations - et si cette configuration a une dimension collective, celle-ci est à moins à rechercher du côté de la neutralité transindividuelle que du côté de la singularité nationale. Personne ne se définit selon une grille collective, sauf peut-être celle du drapeau – lui-même produit d’une pléthore de flux contradictoires. Par exemple, on dira que ce qui est spécifiquement « français » revient à la fois à Pascal et à Voltaire, à saint Louis et à Clémenceau, aux reliques de la Sainte Chapelle et à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le « vrai français » sera bleu blanc rouge, et pas seulement bleu ou blanc ou rouge. Le « vrai français » pourra se réclamer de Jean Jaurès autant que de Maurice Barrès – même si, bien entendu, c’est ce que ne veut surtout pas entendre le disciple de l’un… ou de l’autre. Tout le monde n'est pas Henri Guaino. La condition historique, c’est ce qui nous permet de réconcilier les deux. Et cela s’appelle un humanisme.

2 – Génie de mai 68
Marcel Gauchet ne rejette pas 68. Au-delà du délire libertaire, d’ailleurs pré-libéral (point capital relevé par Houellebecq et avant lui par Michel Clouscard), et en-deça des égarements idéologiques de la racaille d'ultragauche, dont le situationnisme, « surenchère romantique qui n’était en fait qu’un ultra-aristocratisme messianique », l’hybris de « mai » fut surtout l’apparition, pour le pire mais aussi pour le meilleur, de l’autonomie de l’individu.
« Jamais autant de gens n’ont entrepris de prendre en main leurs affaires eux-mêmes, à leur échelle, on a fait, dans des milliers d’endroits, des milliers de projets dans les domaines les plus inattendus. Où que vous alliez, vous tombiez sur des groupes de réflexion divers et variés, qui étaient en train d’élaborer des propositions diverses et variées ».
Le tout sous ambiance psychédélique et déjà « hyperfestive ». Certes, les lendemains furent rudes, et l’on se réveilla souvent avec « la gueule de bois théorique », mais de la minijupe à la Nouvelle Vague, de la pilule à Roland Barthes, de l’amour libre aux radios du même nom, c’est l’ensemble de la société française qui entra dans une nouvelle ère qui est encore et pour bien longtemps la nôtre. Car comme le disait très justement Daniel Cohn-Bendit, les soixuitantards ont gagné moralement et intellectuellement mais ont perdu politiquement. « Heureusement pour tous ! », rajoutait-il en riant. Force est de constater que personne ne voudrait aujourd’hui retourner aux modes d’administration et de gestion d’antan, basés sur le paternalisme patronal ou syndical. L’encadrement autoritaire par lequel « on conduisait les gens sans leur demander leur avis et sans leur dire où, mais pour leur bien » n’a plus cours dans la France post-gaullienne, y compris auprès des plus réactionnaires d’entre nous.
En revanche, c’est la « pluridisciplinarité » qui a échoué. A l'origine, chaque discipline acceptait théoriquement de participer à une fusion des savoirs mais à condition que cela soit elle qui régente les autres. Entre les marxistes purs (presque tout le monde), les psys durs (Lacan), les déconstructeurs en chef (Derrida), les sociologues adjudants (Bourdieu), sans oublier quelques sémiologues arrogants et autres mathématiciens énervés, cette utopie d’une science « totale » n’a pas eu lieu – comme n’a pas eu lieu du reste, et Dieu merci, la fusion des intellectuels et des manuels. Au-delà des impérialismes en rogne, l’échec de la pluridisciplinarité tient d’abord au fait que l’on ne peut sans doute rien faire de sérieux sans Arché, c’est-à-dire sans principe premier, et que le spécialiste d’un domaine ne peut l’être de tous les autres. La loi du père reste la plus forte dans l’épistémologie et la technique !
 Pour autant, on ne compte pas les efforts des penseurs de cette époque pour arracher la subjectivité à l’individualité. Si l’individu trouve son autonomie, celle-ci est désormais une autonomie hors sujet. L’homme n’est plus ce sujet pensant et agissant cher à Descartes mais plutôt un faisceau de relations sociales, filiales, psychiques, et par-dessus tout, linguistiques. L’homme et la société produits et expliqués par la science du langage, tel sera le structuralisme.
Pour autant, on ne compte pas les efforts des penseurs de cette époque pour arracher la subjectivité à l’individualité. Si l’individu trouve son autonomie, celle-ci est désormais une autonomie hors sujet. L’homme n’est plus ce sujet pensant et agissant cher à Descartes mais plutôt un faisceau de relations sociales, filiales, psychiques, et par-dessus tout, linguistiques. L’homme et la société produits et expliqués par la science du langage, tel sera le structuralisme.
L’idée centrale de cette méthode, et qui est rapidement et malheureusement devenue une doctrine, sinon une idéologie, est que « c’est la langue qui parle et non les individus qui s’en servent. » « Ca parle » en l’homme, comme « ça baise », « ça chie », « ça pisse », « ça vit », « ça meurt ». Le langage est considéré comme un système de signes qui fonctionne selon un mécanisme autogénérateur et autoconsistant. « Ca parle » et « ça procède » de l’intérieur. Les structuralistes se proposent alors de rechercher toutes les relations organiques ou inconscientes des termes entre eux. « C’est le fonctionnement du langage qui crée le sujet, ou son illusion d’existence ».
Des structures linguistiques aux structures parentales, il n’y a qu’un pas ethnologique que franchit Claude Lévi-Strauss. Les individus sont moins les acteurs de leur vie que les agents des échanges sociaux et filiaux. C’est le jeu des structures de la parenté qui constitue « le sujet » et qui en vérité le dissout. De même est-il dissout par Michel Foucault qui, dans Les mots et les choses, « prouve » que ce sujet n'est que le résultat d’une succession d’épistémè qui ne sont rien d’autre que des « structures historiques » ayant chacune leur cohérence interne. L’archéologie du savoir consiste alors à révéler au sujet ses différentes matrices.
Ainsi, qu’il soit linguistique, psychanalytique, ethnologique, ou épistémologique, le structuralisme permet de décrire « des univers de pensée en faisant abstraction de ces fictions que sont les auteurs, mais en échappant aussi à un certain réductionnisme marxiste puisqu’il s’agit de décrire des systèmes de productions d’énoncés qui possèdent leur organisation au-dedans d’eux-mêmes. » Si l’aspect doctrinal de cette pensée a été largement abandonné, l’essentiel est resté valable – y compris pour Marcel Gauchet qui y voit l’une des grandes découvertes de notre temps. Que l’homme fasse le monde comme le monde fait l’homme, c’est ce qu’il faut comprendre. En fait, l’erreur des structuralistes fut, à un certain moment, de s’intéresser moins à la norme de leur système qu’à ses « déviations ». Forts de leurs années 68 et de leurs expériences érotico-psychédéliques, ils prirent le risque de discréditer leurs travaux en donnant à la marge une importance plus considérable qu’au centre. L’être humain ne commença de les intéresser que dans ce qu’il avait de bizarre, d’extrême, de « border line ». L’exception devenait la généralité et la philosophie se transformait en singularité esthétique.
De plus, le structuralisme tendait à s’imposer comme la seule explication permise du monde des idées. La méthode se faisait peu à peu déterminisme. L’humanisme de Marcel Gauchet se situe précisément dans ce refus de globalisation pratique et totale des faits et gestes d’une société. Comme le lui fait dire l’un de ses interlocuteurs, « à un certain moment, intervient dans les sociétés humaines un facteur d’orientation tel que les sociétés ne se contentent plus de subir un jeu de déterminisme interne ou externe, mais inventent une direction qui n’obéit à aucun plan. » A un certain moment, le clinamen déraille et la liberté, c’est-à-dire le hasard qui permet la volonté, refait surface. C’est le moment de la sortie de la matrice – en l’occurrence de la pensée mythique et religieuse – et la rentrée dans l’histoire.
Dans les sociétés primitives, le politique n’est qu’une technique qui organise le mythe. Dans les sociétés « modernes », c’est cette technique qui s’est peu à peu substituée au mythe. La condition historique, c’est la prise de conscience de cette substitution. L’homme comprend alors que c’est le politique qui fait le religieux même si le politique arrive après le religieux. Cette arrivée du politique dans le champ intellectuel marque le moment où l’on en termine avec la pensée mythique et religieuse, ce que Gauchet appelle « l’origine absente », c’est-à-dire « une antériorité totalement soustraite à la prise des présents-vivants ». La croyance en tant que telle n’a pas disparue mais elle est devenue une affaire intime.
Dès lors, nous ne pouvons plus revenir en arrière. La perte de l’hymen mythique est irrémédiable. On peut certes toujours s’amuser à être thomiste ou post-présocratique à la manière d’un Heidegger, mais c’est alors pratiquer le jeu enfantin du « comme si ». On fait « comme si » il n’y avait pas eu Descartes, Kant, Hegel, le sujet, la critique, l’histoire, on fait « comme si » l’être en soi précédait la pensée. On fait « comme si » on ne savait pas que la terre était ronde. La philosophie devient alors une affabulation grandiose et subséquemment douteuse sur le plan politique – Heidegger, encore et toujours, « le druide nazi » comme l’appelait plaisamment Deleuze.
 3 – Génie du monothéisme
3 – Génie du monothéisme
Misère du marxisme. Pauvreté de la psychanalyse. Il est remarquable de constater que les sciences modernes ont passé leur temps à rabaisser, sinon à culpabiliser, ce qui, jusque là, avait élevé l’humanité - la grande coupable aux yeux des positivistes étant évidemment la religion.
Contre la haine irrationnelle de l'irrationnel, l’ambition heuristique de Marcel Gauchet est de montrer comment l’avènement du religieux a au contraire entraîné l’avènement de l’état. C’est le sens du fameux « tournant axial », expression que Gauchet emprunte à Karl Jaspers, qui apparaît dans le premier millénaire avant Jésus-Christ et qui coupe littéralement l’histoire en deux. A partir de là, nous entrons dans un monde qui à bien des égards est encore le nôtre.
« Avant ce tournant, on avait affaire à des univers de pensée mythologique que l’on peut à la rigueur reconstituer et déchiffrer, mais qui se donnent à nous sous le signe d’une foncière opacité (…) En revanche, après ce tournant, peu importe qu’on ait affaire à des Chinois, des Perses, des Juifs ou des Grecs, ce sont des mondes qui nous sont spontanément accessibles du point de vue de leur manière de penser, avec lesquels nous avons une sorte de familiarité de démarche. Nous y sommes intellectuellement chez nous. »
En vérité, ce « synchronisme mondial » laisse rêveur. Qu’a-t-il bien pu se passer dans le monde pour que l’idée de l’état « moderne » surgisse partout, au même moment, et sans que les peuples ne se touchent ? Y a-t-il un chaînon manquant dans l'histoire ou est-ce simplement la preuve que tous les hommes ont le sens d’une métaphysique de l’Un qui les conduit à organiser un monde en fonction d’une entité religieuse et politique unique (même si celle-ci prend des formes multiples) ? Ce qui est certain, c’est que sans cette institutionnalisation du divin, l’humanité serait restée primitive.
Donc, l’apparition d’un appareil de pouvoir dominant ne peut être comprise que comme le résultat d'une révolution religieuse. rL’état, ce n’est rien d’autre que la mise en place du divin sur terre - « c’est un fait spirituel qui se convertit en force matérielle ». N’y voyons donc pas, comme les positivistes régressifs et les réductionnistes d'extrême gauche, une simple affaire de dominants et de dominés. Avec l’état triomphant, ce n’est pas simplement une hiérarchie sociale qui est mise en place, avec ses inévitables inégalités, mais une façon de percevoir le monde selon un mode d’identité et d’expansion qui contient en germe la double idée d’universalité et d’impérialisme. « La machine étatique est programmée pour la dilatation et l’absorption universelles. Dès qu’elle surgit, elle tend à déborder de son appartenance native. L’aspiration à la domination mondiale lui est consubstantielle. » Le clan qui se transforme en état, le totem qui devient une divinité pour tous, le surgissement de ces notions si particulières et si humaines de « luxe » et d’ « excellence » et que l’on va bientôt appeler « la culture », constituent un processus de puissance qui en effet apparaît universel. Le propre de l’homme, ce n’est pas de vivre de baies et d’eau fraîche, c’est d’avoir des monuments, des esclaves, une armée, une administration, une église, bref, une possibilité de vivre dans la violence et le sacré et le pouvoir d’ inscrire tout cela noir sur blanc.
D’ailleurs, si l’homme se met à écrire, c’est moins pour compter ses silex et calculer ce qu’ils valent en peaux de mammouth que pour se remémorer les grands puis les petits moments de sa vie. Des grottes de Lascaux à l’apparition des premiers hiéroglyphes, en passant par l’écriture cunéiforme, l’homme prouve qu’il est avant tout un être métaphysique qui a le désir de donner de l’éternité aux choses ainsi que celui, fou et excellent, de rendre visible l’invisible. Si l’écriture a une origine sacrée (et non pas utilitaire, comme on le dit trop souvent), c’est parce qu’elle vient de cette émouvante volonté d’attester de la création, d’inscrire le divin dans la terre et dans la chair, de faire, enfin, de l’esprit une lettre. A ce propos, notons que les premiers individus dignes de ce nom, « les premières vraies personnes attestées par l’histoire », sont bien des « intellectuels » - c’est-à-dire des êtres qui pensent au-delà de leur propre espèce, sinon contre l’objectivité « préhistorique » des choses, et qui se chargent, tels Confucius, le Bouddha ou les prophètes d’Israël, d’éduquer leurs congénères. L’intellectuel, c’est l’aristocrate qui va au peuple et lui révèle qu’il vit dans une grotte, dans le péché, ou les deux.
Bref, l’on sort peu à peu de cet ordre païen, immuable, « objectif », des premiers temps. Ce qui va réellement changer avec le monothéisme, c’est l’idée que le divin n’est plus le lieu des représentations naturelles des phénomènes (Mars - le feu, Vénus - l’amour, Pluton - la mort, etc.) mais plutôt celui de ce que l’on pourrait dénommer une subjectivation par le haut - en d’autres termes, une transcendance. Dans le polythéisme, le divin est l’autre nom que l’on donne à la nature. Dans le monothéisme, le divin devient intentionnel, sinon interventionniste. Dieu fait alliance avec le monde, ou plus exactement avec un peuple : Israël, dont la mission sera de l’affirmer, Lui, Jahvé, comme le dieu unique et éternel.
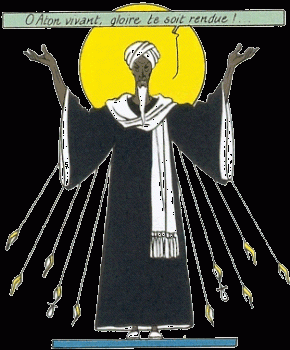 Or, alors qu’on croyait en avoir fini depuis longtemps avec la question de la spécificité du monothéisme, voici de part et d’autre, et au sein des travaux publics contemporains, de nouvelles résistances, souvent le fait d’opinions demi-savantes (dont Michel Homais-Onfray est sans doute la figure de proue) qui se remettent à contester celle-ci. On déteste tellement l’exception du dieu unique, sinon l’exception d’Israël, qu’on veut dissoudre l’invention du monothéisme dans les anciennes traditions polythéistes. On généralise abusivement, on fait des amalgames entre Zoroastre, Aton, et Jahvé, on gomme les différences, et on impose cette erreur grossière qui consiste à penser que soit tout le monde a été monothéiste, soit le monothéisme est au mieux un hénothéisme [sorte de monothéisme arrangé (et arrangeant !) où l'on accepte tous les dieux en même temps sans que l'on en privilégie un]. N’en déplaise à tous ces anti-judéo-chrétiens à côté de la plaque, dont la religion est certainement l’ignorance et l'incompétence, le monothéisme juif est une particularité absolue dans le monde antique. Et son caractère premier est précisément d’exclure le polythéisme. Qu’il lui emprunte quelques traits ne signifie pas du tout qu’il fonctionne comme lui. En fait, et comme le dit si justement Marcel Gauchet, « l’invention du monothéisme consiste à se servir de ce qui se passe chez les autres pour en faire autre chose, et pour définir sa propre identité ». Voici donc une configuration politique et sociale extraordinaire où ceux qui sont dominés politiquement prétendent dominer spirituellement et intellectuellement. Comme le dira Nietzsche plus tard, le génie (ou la perversité) du monothéisme judéo-chrétien n’est rien d’autre qu’une culpabilisation des maîtres par les esclaves. Dans le polythéisme, tous les dieux étaient égaux mais les hommes ne l’étaient pas. Dans le monothéisme, les dieux ne sont plus égaux, d’ailleurs il n’en reste plus qu’un, exclusif, amoureux, et intolérant, mais les hommes sont égaux (ou vont le devenir.) C'est donc par le monothéisme juif que nous prenons conscience de notre force et de la faiblesse qui consiste à s'en servir contre les autres. Le juif est celui qui nous fait honte de notre force. Le chrétien est celui qui se laisse humilier par nous tout en nous signifiant qu’il vaut mieux être à sa place qu’à la nôtre. D’Abraham au Christ a ainsi lieu le retournement moral et dialectique le plus saisissant de toute l’histoire des idées. Et le début d’une série de paradoxes qui finiront par achever l’ancien monde.
Or, alors qu’on croyait en avoir fini depuis longtemps avec la question de la spécificité du monothéisme, voici de part et d’autre, et au sein des travaux publics contemporains, de nouvelles résistances, souvent le fait d’opinions demi-savantes (dont Michel Homais-Onfray est sans doute la figure de proue) qui se remettent à contester celle-ci. On déteste tellement l’exception du dieu unique, sinon l’exception d’Israël, qu’on veut dissoudre l’invention du monothéisme dans les anciennes traditions polythéistes. On généralise abusivement, on fait des amalgames entre Zoroastre, Aton, et Jahvé, on gomme les différences, et on impose cette erreur grossière qui consiste à penser que soit tout le monde a été monothéiste, soit le monothéisme est au mieux un hénothéisme [sorte de monothéisme arrangé (et arrangeant !) où l'on accepte tous les dieux en même temps sans que l'on en privilégie un]. N’en déplaise à tous ces anti-judéo-chrétiens à côté de la plaque, dont la religion est certainement l’ignorance et l'incompétence, le monothéisme juif est une particularité absolue dans le monde antique. Et son caractère premier est précisément d’exclure le polythéisme. Qu’il lui emprunte quelques traits ne signifie pas du tout qu’il fonctionne comme lui. En fait, et comme le dit si justement Marcel Gauchet, « l’invention du monothéisme consiste à se servir de ce qui se passe chez les autres pour en faire autre chose, et pour définir sa propre identité ». Voici donc une configuration politique et sociale extraordinaire où ceux qui sont dominés politiquement prétendent dominer spirituellement et intellectuellement. Comme le dira Nietzsche plus tard, le génie (ou la perversité) du monothéisme judéo-chrétien n’est rien d’autre qu’une culpabilisation des maîtres par les esclaves. Dans le polythéisme, tous les dieux étaient égaux mais les hommes ne l’étaient pas. Dans le monothéisme, les dieux ne sont plus égaux, d’ailleurs il n’en reste plus qu’un, exclusif, amoureux, et intolérant, mais les hommes sont égaux (ou vont le devenir.) C'est donc par le monothéisme juif que nous prenons conscience de notre force et de la faiblesse qui consiste à s'en servir contre les autres. Le juif est celui qui nous fait honte de notre force. Le chrétien est celui qui se laisse humilier par nous tout en nous signifiant qu’il vaut mieux être à sa place qu’à la nôtre. D’Abraham au Christ a ainsi lieu le retournement moral et dialectique le plus saisissant de toute l’histoire des idées. Et le début d’une série de paradoxes qui finiront par achever l’ancien monde.
Pour l’heure, il faut diffuser le message. Or, « une chose est de posséder l’idée du dieu universel, autre chose est d’y faire entrer les autres peuple. » Ce que le judaïsme orthodoxe n’a jamais pu faire, un judaïsme hérétique – le christianisme - va s’en charger. Avec l’avènement du Fils, la loi du Père ne devient effective que si on en comprend le sens dans son cœur. Il s’agit donc moins de l’appliquer à tout vat que de l’intérioriser. Sauf qu’une fois qu’on l’a intériorisée, on ne trouve plus le besoin de l’appliquer. Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre. On comprend que cela énerve beaucoup de monde. Les juifs qui blâmaient les païens d’être impies, voilà qu’un juif d’un caractère un peu « spécial » les blâme d’être trop pies. Pire, ce juif, qui se prétend le messie, argue qu’il est venu pour sauver tout le monde, et plus seulement les juifs. On comprend que le messianisme rabbinique fasse un peu la gueule.
En outre, et c’est le pire du comble, il ne s’agit plus tant de libérer les corps que de libérer les âmes. Il faut, déclare ce nazaréen improbable, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans ce cas, adieu la révolution ! Alors qu’on se préparait à renverser les dominations, voilà qu’on vient nous apprendre que l’on n’en sortira pas par la force, et qu’au lieu de nous battre, nous devrions plutôt nous aimer les uns les autres. La « bonne nouvelle » de ce Christ problématique, c’est qu’il n’y a pas d’issue ici-bas et qu’il faut s’en contenter ! Le royaume de Dieu n’est pas de ce monde, et il nous faut désormais subir celui-ci pour avoir la récompense de celui-là. Tu parles comme ça contrarie nos plans ! Contre toute attente, et c’est le cas de le dire, le christianisme est la première religion qui en finit avec le messianisme.
Là aussi, tout s’inverse. Le fort devient faible, le faible devient fort. Le triomphe du Christ ne réside pas dans la prise du pouvoir, mais dans son sacrifice pour les hommes. Comme le précise Gauchet, peu importe, au demeurant, ce qui s’est réellement passé, ce qui compte, c’est le récit qui nous en reste et qui nous parle comme jamais aucun « mythe » ne nous a jamais parlé. Et d’ailleurs, ce n’est pas un mythe. René Girard a tout dit là-dessus : le christianisme est la religion qui vient abolir le mythe. Le christianisme est la religion qui vient abolir les traditions ancestrales, abolir la mentalité primitive de l’humanité qui était fondée sur le sacrifice de l’autre, c’est-à-dire sur le bouc émissaire. En donnant son Fils à sacrifier, le Père révèle l’horreur du sacrifice. Et ce faisant, rend l’humanité vraiment humaine.
« Le Christ, ou la figure d’une défaite apparente qui est en réalité une victoire. Dans le regard des païens de l’Antiquité, le fait que le Christ ait été méconnu, traité comme un malfaiteur et crucifié témoignait de son insignifiance et de l’absurdité de la foi de ses adeptes, Eh bien, c’est le contraire qu’on a pu vérifier ! De la religion des faibles et des esclaves est sortie une civilisation d’une puissance incomparable, dont le génie constant a été de prendre le contrepied des apparences de la puissance. Affaiblir le gouvernement en donnant le droit de vote à tous. (…) Qui aurait pu croire que l’impuissance pouvait être le ressort de la vraie puissance ? »
Qui aurait pu croire, surtout, que le christianisme allait s’inscrire dans l’histoire ?
Qu’on y croit ou non, l’incarnation, puis la résurrection constituent des événements symboliques d’une importance historique considérable puisque c’est la condition humaine qui y est bouleversée de fond en comble. L’incarnation, c’est la rencontre de Dieu dans l’homme, c’est la béance humaine visitée par la transcendance. La résurrection, c’est le retour de l’homme en Dieu, c’est la mort vaincue et la vie, c’est-à-dire la souffrance, acceptable. Le Christ ne vient pas abolir la souffrance mais l’emplir de sa présence, écrivait Paul Claudel.
Avec la folie et le scandale de la Croix, rien ne sera plus comme avant. Le cycle de l’éternel retour est brisé. Le clinamen a éclaté. Rien ne sera plus aussi carré et aussi barbare que ce le fut. Les droits de l'homme sont déjà en germe dans la vertu théologale de la charité. Force et faiblesse ne sont plus des réalités en soi mais des relations dialectiques où les forts seront les faibles comme les premiers seront les derniers. Le monde n’est plus le fait du destin aveugle, immuable et cruel, mais le dessein de Dieu.

4 – Génie du christianisme.
Et d’abord en finir une bonne fois pour toutes avec le pire préjugé de tous les temps et qui pollue encore de nos jours débats et discussions : une religion digne de ce nom n’est pas le fait de quelques fidèles qui se réuniraient en mémoire d’un enseignement « originel » qu’ils prétendraient garder vierge de toute interprétation, mais le fait d’un processus historique dans lequel cet enseignement ne cesse d’être interprété, clarifié, modifié, augmenté selon les intellectuels et les prêtres qui composent son église. En clair, il n’y a pas de christianisme « authentique » (pas plus qu’il n’y a d' islam authentique, ou de bouddhisme authentique.) Un chrétien du XXIème siècle n’est pas moins proche de Jésus qu’un apôtre de son temps. Etre chrétien, c’est être contemporain du Christ à tous les temps. Si le Christ s’adresse à tous les hommes, cela signifie que n’importe qui, n’importe quand, peut se retrouver en lui, le comprendre et l’aimer, mieux même que ceux qui l’ont côtoyé à l’époque. Kierkegaard ajoutera que plus on est loin de son temps, plus l’on est proche de lui. « Heureux ceux qui croient sans voir », disait le Christ à Thomas.
Ce qu’il faut comprendre, s’il n’y a qu’une chose à retenir, c’est que tout est médiation dans le christianisme. Il y le Père, le Fils, le Saint Esprit. Il y a le Messie, les apôtres, les pères de l’église, l’église. Il y a, du moins dans le catholicisme et l’orthodoxie, l’enfant Jésus, la vierge Marie, les anges, et tous les saints. Il y a Jean-Baptiste, enfin, qui baptise le Christ.
Il y a surtout saint Paul, l’apôtre le plus contesté, que l’on accuse, encore de nos jours, d’avoir trahi le message « originel » du Christ, alors qu’il est le seul à l’avoir réellement compris et le premier à l’avoir diffusé. Pour que l’enseignement du Christ s’universalise pour de bon, il fallait à la fois se convertir à lui et prendre des distances avec sa famille « nucléaire ». Il fallait l’arracher à sa famille et l’offrir au monde. Et c’est parce que Paul, le plus subtil et le plus sublime des génies humains, était en effet extérieur au clan primitif (d’ailleurs qu’au début il persécutait) qu’il a pu comprendre le Christ de l’intérieur, et saisir en lui ce qu’il y avait d’universel. Sans lui, le christianisme serait resté une secte ésotérique, communautaire, sinon consanguine.
Ce que Paul va mettre en branle, c’est un processus d’hominisation via le christianisme. Etre chrétien, c’est sortir de la sphère incestueuse de la meute. Etre chrétien, comme n’aurait pas dit l’autre, c’est préférer sa nièce à sa fille, sa cousine à sa nièce, sa voisine à sa cousine.
Impossible, pourtant, d’actualiser tout cela sans organisation institutionnelle et sociale. Sans église, une religion n’est rien. Par chance, on dispose à l’époque du modèle romain. Un état fort, bien organisé, extrêmement efficace. Pourquoi s’en priver ? Avec la conversion de Constantin, le prosélytisme paulinien est entériné. L’église, Etat divin s’il en est, est ce lieu matériel de la force spirituelle. C’est la réunion du temporel et de l’intemporel, sans que le temporel ne l’emporte. C’est l’instance médiatrice qui assure l’enseignement du Christ et qui d’ailleurs a été voulu par lui – « sur cette pierre, etc ». Qu’on ne se leurre donc pas, le lien entre le Christ et le clergé n’est pas accidentel mais bien consubstantiel à l’Evangile. Comme le précise Gauchet, « la duplication du Christ en Eglise du Christ n’est en rien une déviation du message originel, mais une de ses propriétés structurelles. » Etre chrétien, ce n’est pas seulement croire en Dieu, c’est jouir d’une une intellectualité qui comprenne que la médiation appelle une autre médiation, et que tout ce qui intercède entre Dieu et moi est à vénérer. Le génie du christianisme est catholique, apostolique et romain.
Par ailleurs, il y aussi l’idée, o combien scandaleuse pour un égalitariste du XXIème siècle, que la vérité chrétienne est trop forte pour les esprits ordinaires. L’ineffable, ce n’est pas à la portée de tous. Il faut une élite qui explique aux ouailles ce que l’Evangile veut dire. Sans intermédiaire, sans aristocratie, le sacré vire au massacre. Et puis, il faut veiller à ce que les hérésies ne l’emportent pas - quoique l’église sache qu’ « oportet haereses esse » - qu’il est opportun qu’il y ait des hérésies. Car celles-ci aident à clarifier le dogme, à nuancer la vérité (c’est-à-dire à la renforcer), à légitimer la raison – car le christianisme, on l’oublie trop souvent, est une religion qui affirme la grâce autant que la raison. Le bûcher, c’est vraiment pour ceux qui persistent à penser que deux plus deux font trois ou que deux droites parallèles se croisent.
L’hérésie, c’est aussi la tentation de la gnose. Si l’on peut dire de la révélation chrétienne qu’elle est problématique, cryptique, on ne peut dire qu’elle est ésotérique ou gnostique. La connaissance de Dieu n’est ni une connaissance de soi ni une connaissance occulte. Aucun prêtre, aussi « élitiste » soit-il, ne peut garder la vérité pour lui ou pour ses pairs. Le Christ, c’ était l’aristocrate qui allait au peuple. L’église délivrera une parole publique « urbi et orbi », à la ville et au monde. Pas de cachotterie dans la curie. Pas de Da Vinci code dans l’exégèse. Il y un mystère de Dieu, il n’y a pas un « secret » de Dieu. La théologie, c’est compliqué mais c’est publique ! Et c’est cette dialectique entre casuistique et doxa, orthodoxie et tentations hérétiques, transcendance et transmission, qui confère « une tension formidable au statut de la vérité » et donne à l’esprit une formidable vie.
Le miracle est que cela ait duré !
« Le symbole de Nicée, qui soulignait d’une certaine manière l’irrationalité du dogme, n’aurait jamais dû l’emporter. Le sens intuitif de l’originalité du dispositif christique a été suffisamment fort pour maintenir le double jeu de l’humain et du divin, au lieu de la restauration de l’unité en bonne et due forme qui eût été l’issue normale – je veux dire conforme à la pente de l’acquis. »
A moins que cette pérennité ne soit juste la preuve que Dieu existe ? Dans tous les cas, c'est encore Mordillat et Prieur qui ne vont pas être contents....
